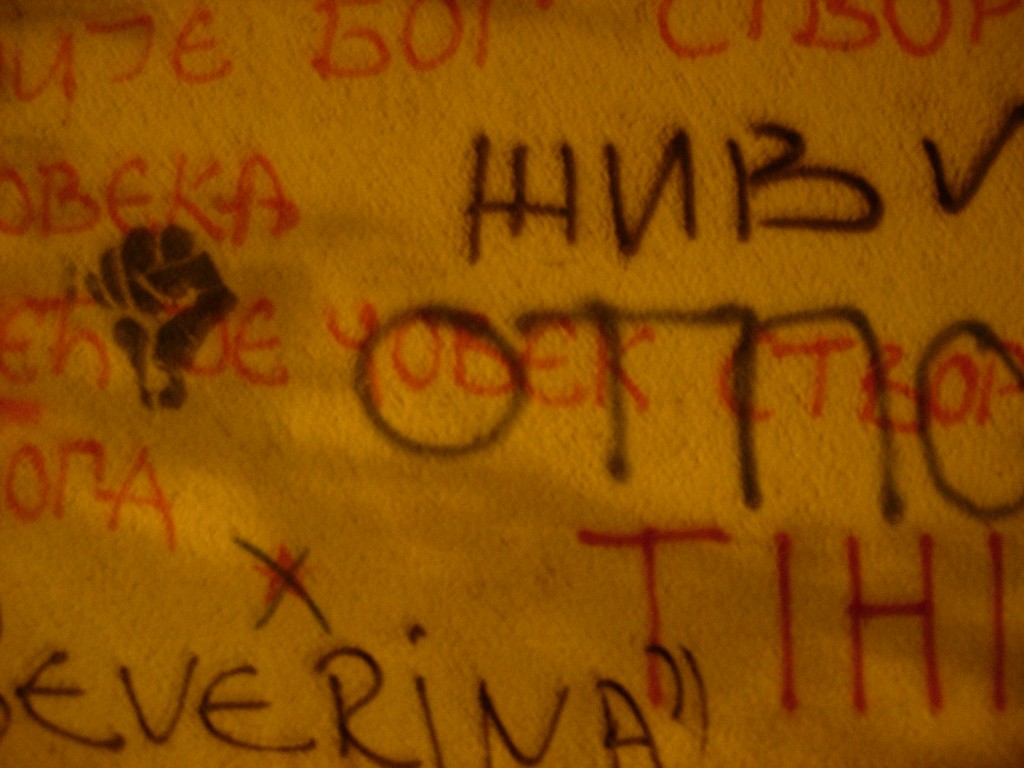Pancevo est une petite ville serbe. Entre passé militaire et désœuvrement, chacun cherche à tromper l’ennui à la recherche de l’oubli dans un verre d’alcool, une piqûre d’héroïne.
L’extrait proposé est issu d’une série de reportages effectués entre 2006 et 2008, dans la ville de Pancevo, Serbie, dans la province de Voïvodine, au cours de longs séjours, en vivant avec les habitants. L’auteur est retournée ensuite dans cette même ville, Pancevo, à deux reprises en 2012 et en 2013.
Ses interlocuteurs lui assurent que « rien n’a changé ».
Ce texte reflète une expérience vécue et s’appuie sur des témoignages recueillis directement auprès d’habitants qui ont une trentaine d’années, musiciens, artistes, journalistes, enseignants.
Pancevo occupe une place particulière en Voïvodine. Perméable aux influences « branchées » venues de la capitale toute proche — douze kilomètres — c’est aussi une petite ville hérissée des constructions typiques de l’architecture austro-hongroise. Une petite ville où tout le monde se connaît. Une ville industrielle qui regroupe des usines recrachant une pollution mortifère. Mais c’est aussi une ville au passé militaire, qui recèle garnisons et cantonnements, terrains d’entraînement pour les corps d’élite de l’ancienne armée fédérale.
La drogue
Krisijan, journaliste : « Ici, tu peux trouver ce que tu veux. En une heure, je te trouve ce que tu veux. Pancevo, pendant les années 90, c’était un putain de supermarché. Tu voyais des gamins, l’été, des mômes de treize ou quatorze ans, avec des t‑shirts à manches longues pour cacher les marques de piqûres sur leurs bras. Il y a un coin à Streliste qui était connu à cause de la facilité pour se procurer de l’héroïne. Pendant les années 90, on voyait rôder des gens en voiture avec une plaque d’immatriculation de Belgrade ou de Vrsac ; ils venaient tous ici pour se fournir. Beaucoup de drogues viennent du Kosovo, c’est la plaque tournante du trafic. Femmes, came, bagnoles, tout passe par là. Nous aussi, on a essayé. D’abord sniffer, puis se piquer, une fois ou deux. J’ai pas trop aimé ça. Rien. L’héro, c’est le rien et il y a assez de rien autour de nous sans qu’on s’en balance dans les veines en plus. Je ne touche plus à tout ça depuis des années. J’ai beaucoup bu, ici tout le monde boit beaucoup, tu as du t’en rendre compte. Mais pour sortir de ce merdier, pour faire des plans d’avenir, il faut avoir les idées claires. Il faut lutter contre la déprime et trop d’alcool c’est la déprime assurée. Alors je ne bois presque plus, sauf dans les fêtes. »

Danijel : « L’héro m’aide à transcender une réalité insupportable. Je sais que ce n’est pas la solution idéale, mais j’arrive à maîtriser ma consommation. Je n’aime pas l’alcool. Ici les gens traînent toute la journée dans les kafanas et se bourrent la gueule à se rendre malades. C’est une petite ville, tu croises les mêmes gens sans arrêt. Du coup, tout le monde sait ce que fait tout le monde. Je n’aime pas ça. Je n’aime pas être au milieu de tous ces gens, toujours les mêmes. Alors je fais ma vie de mon côté. Pendant la journée, je bosse, le soir, je rentre chez moi ; j’écoute la musique que j’aime et je me fais mon rail. Je ne me suis jamais piqué. Pendant un moment j’en ai pris trop, je m’en suis rendu compte. Lorsque je redescendais, j’étais anéanti, je ne supportais plus rien ni personne. L’héro ne transforme pas la réalité qui t’entoure, mais elle agit en toi et tu te sens plus calme, plus fort. Quand je sniffe, je suis le roi du monde et je n’ai plus peur de rien.
Je n’ai pas eu beaucoup de copines dans ma vie, celle que j’ai aimée de toutes mes forces m’a quitté. C’était il y a des années. Maintenant elle est mariée avec un autre et elle a des enfants. J’ai encore le cœur qui se déchire lorsque je la croise en ville. Je suis catholique tu sais. J’ai été enfant de chœur pendant mon enfance, dans une petite église du centre. C’était super, je voyais des copains qui étaient enfants de chœur aussi, là-bas, tous les dimanches. Ce sont de très beaux souvenirs, très purs. Ce qui me fait tenir le coup maintenant c’est la musique que je fais avec mon groupe. On répète sérieusement et on croit à ce qu’on fait. Peut-être qu’à force de persévérer, on arrivera à quelque chose. Pour l’instant on joue dans des petits clubs ici et à Belgrade. En général on n’est pas payés pour ça. Mais c’est comme ça qu’un groupe se fait connaître et travaille. J’y crois. J’ai besoin d’y croire. »
L’armée
Dejan : « J’ai effectué mon service militaire en 2004. J’ai eu de la chance, je me suis retrouvé dans la marine fluviale, ça aurait pu être pire. Le seul problème, c’est que c’était l’hiver serbe le plus froid depuis vingt ans. On était cantonnés dans des bateaux sur le Danube, près de Novi Sad. C’était dégueulasse. Des vieux bateaux… Douze mecs entassés dans un bateau pourri où il fallait casser la glace le matin au-dessus des couchettes en se levant. Je préfère ne pas te parler de l’état des chiottes. Des toilettes à la turque, très sales. J’ai récupéré une vieille chaise et je l’ai installée dans les chiottes. Une chaise où il manquait l’assise, le truc pour s’asseoir, mais la structure en fer était là. Je me suis servi de ce truc pendant neuf mois pour chier proprement, comme un être humain et non pas comme un animal. Il faut voir ça pour le croire ; tu te retrouves avec des types venus de toute la Serbie, des campagnes, de bleds pourris. Certains n’ont même pas terminé l’école primaire. Ils ne connaissent rien, ne savent rien. Ils ont eu la télé et c’est tout. Bien sûr, ils ne sont jamais sortis du pays. Des types très rustres, très ignorants.
Moi, j’étais impliqué dans mes études de lettres et j’ai pu voyager avant l’embargo sur la Yougoslavie. Mais à l’armée, il y avait toutes les drogues que l’on voulait. De l’herbe, des pilules d’amphétamine, de l’héroïne, de tout. Et bien sûr, des clopes et de l’alcool tout le temps. On mettait trois ou quatre pulls sous nos vestes d’uniforme pour ne pas sentir le froid. Mais on avait froid quand même. Alors l’alcool, c’était pour tenir le coup. Là-bas, j’ai fait la vaisselle à l’eau froide trois fois par jour, sans gants et pour deux cent personnes. En plein hiver. C’est ça l’armée : tu te retrouves à partager ton quotidien avec des fous que tu ne connais pas et entre le lever et le coucher, tu fais ce qu’on te dit de faire. Et avec plein de drogues et d’alcools au milieu. T’as vu les photos ? Il y a de tout sur la table… Et à côté, la marmite de bouffe. Remarque, je ne sais pas si on va vivre très vieux. Mais qui s’inquiète de ça, à part nos mères ?
J’ai fait des trucs dingues quand j’étais là-bas. Un soir, je suis sorti sans permission, mais tout le monde le faisait plus ou moins. Je suis allé me balader dans le centre ville de Novi Sad. J’ai réussi à baratiner une fille dans un bar et je l’ai ramenée jusque devant mon bateau. Il y avait un banc sur l’embarcadère. On a baisé sur le banc, devant le bateau, par moins dix degrés. Personne n’a rien su, sauf les copains quand je suis rentré à cinq heures du matin. Enfin c’est ce que je croyais. Jusqu’à ce que le lendemain soir, notre commandant s’amène. Un vieux type, gros, avec les galons toujours un peu de travers sur sa veste d’uniforme. Il nous a parlés pendant un moment de ce que l’on aurait à faire le lendemain. On était tous un peu étonnés qu’il vienne nous voir juste pour ça, mais on n’a rien dit. Puis il est arrivé devant moi et il m’a attrapé par l’épaule, il avait une poigne de fer, ce con. Il s’est approché de mon oreille et il m’a dit : « Vous êtes tous comme mes fils. Pas parce que j’ai couché avec votre mère, mais parce que je sais ce que c’est. Alors, faites ce que vous voulez, mais essayez de ne pas vous faire prendre.» Puis, il a bu avec nous, dans le bateau. Il est resté jusqu’à deux heures du matin. Il a fallu l’aider à rentrer se coucher.
L’incertitude, l’ennui, le désoeuvrement. La recherche de l’oubli.
Une nuit glaciale de décembre, nous assistons à un concert au Aleksandar Cafe où des groupes de rock locaux se produisent régulièrement. Il est minuit lorsque nous émergeons du club enfumé. La neige tombe en abondance, les flocons tourbillonnent dans le halo des réverbères avant de poudrer le sol et nos épaules. Un groupe d’adolescents gueulards hante le terrain de jeux à proximité en vidant bruyamment ces petites bouteilles vertes de liqueur Gorki List, que je reconnais facilement maintenant. Apparemment insensibles au froid, ils se bousculent entre les toboggans en jouant à se dénuder le torse, criant sous les étoiles, la tête renversée en arrière. Quelques mètres plus loin, notre petit groupe fait halte sous une porte cochère pour acheter de l’herbe à Goran qui bat la semelle pour lutter contre le froid. C’est un homme petit et maigre, entre deux âges, coiffé d’un bonnet coloré à oreillettes, qui grommelle des phrases sibyllines en anglais à mon intention. Ce bonnet posé au-dessus de ses rides le fait ressembler à une caricature de Manu Chao balkanique. (Ressemblance qu’il cultive en proposant ses sachets d’herbe cachés dans une biographie de Che Guevara).
Encombrés de Goran qui se décide à nous accompagner, nous nous déportons en groupe au Had Cafe pour finir la soirée. Le Had est un club tout en bois, mansardé, situé au premier étage au sommet d’un escalier en fer branlant. On peut y jouer aux fléchettes ou se saouler en demandant à écouter son air de rock préféré, choisi sur un écran d’ordinateur bleuâtre relié aux baffles, derrière le comptoir. C’est le dernier bar ouvert à Pancevo, il ferme à six heures du matin ; on est certain d’y retrouver les soirs de week-end tous les copains éparpillés dans la ville qui viennent terminer la soirée. L’été, sa terrasse sur le toit est prise d’assaut paraît-il. Ceux que je connais me recommandent le Had tout en me disant de m’en méfier. C’est l’épicentre des rares bagarres alcoolisées de Pancevo : coups de couteaux, bousculades, violences et des gens pas recommandables. Soucieux de mon honneur, mes copains m’avertissent.
L’endroit ressemble à un bateau ivre : bondé, des poutres, des lampes tempête accrochées aux cloisons de bois, le rock pulse et tout le monde est saoul ou en passe de l’être. J’aperçois Vladimir, Lif en grande conversation avec une jeune fille en dos nu à paillettes et d’autres visages connus. Je m’installe à une table en face d’Ana, vingt-deux ans, qui arbore une fée Clochette tatouée dans le dos. Je l’ai déjà croisée, au hasard des soirées dans le centre ville, souvent occupée à retoucher son maquillage dans les toilettes. Goran, effondré sur la banquette à côté d’Ana, me tend un écouteur de son baladeur. Ana qui fume avec de grands gestes étudiés, s’empare de l’autre écouteur et hoche la tête en cadence. Elle me raconte son fiancé, parti sur les mers travailler comme steward « pour voyager » : il lui manque. Elle parvient à fumer, à boire une bière et à mâcher son chewing-um en même temps. Goran, en verve, m’apostrophe : qu’est-ce que j’aime comme musique ? Qu’est-ce que je fous à Pancevo ? Ai-je conscience de la difficulté de vivre ici ? Il tient à m’offrir un de ses bracelets en plastique en souvenir de notre rencontre, et, bredouillant sous son bonnet, il affirme que j’ai l’esprit du rock et de l’aventure en moi, ça se voit, il s’y connaît. Puis, apparemment accablé par le poids de l’esprit du rock, il s’effondre sous la table, les bras en croix, dans l’indifférence générale. Kristian fait la queue au bar, au milieu de la foule, Danijel, d’habitude impassible, parle avec animation à une jeune fille. Le rire tonitruant de Veljko me parvient de l’autre côté de la salle.
La marée humaine crie, jacasse, les couples se cherchent. Je discute au comptoir avec le patron, un petit homme blond aux manières vives, qui a récemment voyagé en France, en Normandie. Il me décrit le mépris des gens à son égard et ce qu’il appelle leur ignorance : « Ils ne parlent même pas anglais ! » Je rencontre Kristina et son mari, un couple d’une trentaine d’années dont on me dira plus tard qu’ils sont des junkies. Souvent, j’entends des histoires comme celle-là. Celle de gens qui sont tombés dans la drogue, à pieds joints, pendant ces terribles années 90, comme par fatalité, par résignation. La drogue, c’est-à-dire l’héroïne brune qu’on trouve très facilement. Provenant d’Afghanistan ou du Pakistan, elle transite par le Kosovo et le marché local a littéralement explosé dans les années 90. La cocaïne est rare et sa consommation reste cantonnée aux clubs et aux bars branchés, essentiellement belgradois. Le principal attrait de l’héroïne, outre la rapidité avec laquelle on peut s’en procurer, c’est son prix : entre vingt et vingt-cinq euros le gramme. J’entendrai encore d’autres histoires tristes. Comme celle de ce copain de Kristian et Daniel, M. un ancien musicien de rock tombé dans le piège de l’héroïne et qui a fait la « une » du journal local : entre deux séjours en prison, il a fini par assommer sa mère dans son appartement pour lui voler un peu d’argent. L’ennemi principal, c’est l’ennui : pas de travail, pas de perspectives.